
Mon grand ami Bouachiche,
Ce retour de la fanfare au village de la réflexion est triplement bénéfique : vous amorcez une réflexion pontifiante sur la notion de monstrueux, laquelle s’accouple avec les nouveaux monstres que sont les personnalités télévisuelles fabriquées par des castings et des normes de conduite, et enfin vous faites de ces normes modernes un genre de dictature encore plus néfaste que la dictature telle que nous avons l’habitude de la fréquenter dans les livres d’histoire. Il en va alors de la santé de la pensée : comment s’orienter convenablement quand il semble évident que le bon chemin exige de la raison un éclairage plutôt qu’il ne s’annonce déjà tout éclairé ? Sur votre lancée, je déclare sans risquer l’intrépidité que la vieille rengaine des Expositions Universelles ne produit rien de véritablement pertinent, ceci dans la mesure où ce sont plutôt des attitudes commerciales qui se chevauchent au lieu d’attitudes heuristiques motivées par la curiosité. Aussi la présence d’une épice orientale sur un marché sud-américain n’a de remarquable que la capacité de maîtriser l’espace mondial. En matière d’échanges de curiosités, tout repose sur la faculté de fréquenter la curiosité sans la réduire ensuite à un processus sérigraphique. C’est pourquoi nos monstres sociaux ne sont plus particulièrement monstrueux : on leur donne un espace désigné qui leur attribue le droit d’être des monstres, ce qui permet aux systèmes judiciaires de contenir le monstrueux alors qu’ils ne le comprennent manifestement pas.
Outre cela, la vraie qualité du monstre repose sur sa capacité à être un produit de la nature alors qu’on le dit surnaturel et difforme. Je connais le succès considérable de ces émissions voyeuristes qui épient le quotidien de quelques siamois. Le cas des êtres bicéphales est selon moi un exemple de somatisation de ce dualisme rationnel contre lequel je me bats depuis des années. Deux têtes en un corps doivent-elles nous conduire à la thèse de deux âmes qui s’affrontent pour un même quignon de pain ? Ces demandes grotesques se dirigent vers un autre genre de question ridicule : l’être bicéphale doit-il être baptisé deux fois ? Peut-on envisager le mariage sans risquer le threesome qu’on connaît en France sous le nom de triolisme ? Pire encore : est-ce que la participation de ces siamois à un jeu de culture générale peut-elle être envisagée comme un acte de tricherie à qui n’a que sa tête pour banque de données ? Si le siamois est donc mieux accepté par le regard scrutateur des somnambules chômeurs qui s’avachissent des nuits durant devant la télévision, il n’en reste pas moins que le siamois devient non plus monstrueux en tant qu’être de chair mais monstrueux en tant que contournement des attitudes ludiques. A ce titre, je n’ose imaginer quels seraient les commentaires si des frères siamois devaient un jour s’adonner à la passion du football. Ceux-ci auraient deux fois plus de chance de marquer de la tête, ce qui bouleverserait le métier des statistiques aussi bien que la façon d’appréhender le commentaire des gestes techniques.
Dès lors, même si G. Canguilhem disait du monstre qu’il est un « vivant de valeur négative » (cf. La connaissance de la vie), je crois néanmoins que le monstre représente davantage un être de providence qui supprime les tentations dualistes des naturalistes en supposant un retour à la création naturelle en tant que totalité inexplorable. La prétention de la raison à se substituer aux problèmes épineux de la connaissance me paraît un homicide de la pensée au détriment d’une activité maîtrisée de la connaissance. J’entends par maîtrise de la connaissance deux critères inévitables : 1. La nécessité de ne pas se disperser dans la recherche en acceptant de laisser à qui de droit le travail en certains domaines – sur les hommes à deux têtes, le médecin aura plus de compétences que le chômeur voyeur avide de se remplir d’images alors qu’il ferait mieux de fortifier les significations de son voyeurisme inutile (ceci n’est que le mauvais côté du « divertissement » de ceux qui trouvent à se divertir de n’importe quoi en demeurant des n’importe qui). 2. Faire de la curiosité non pas une fédération de toutes les connaissances mais bien une alimentation du dialogue entre interlocuteurs statistiquement complémentaires – je ne peux ici cautionner un titre dualiste comme La belle et le clochard, œuvre pathologique et terroriste des studios Disney (aucune belle n’est jamais tombée amoureuse d’un clochard et cela n’arrivera jamais au vu des normes qui régulent la société). L’aboutissement de la connaissance maîtrisée consisterait en une sorte de connaissance sophrologique où la raison, au pinacle de son exercice, accepterait de reculer en s’apercevant qu’elle s’immisce sur des territoires qui ne sont pas réels mais créés de toutes pièces par elle à la seule fin de se donner l’illusion qu’un espace théorique saura résoudre les maladies de l’espace expérimental. C’est en ce sens que le chômeur, à l’instar de l’étudiant de basse-cour, ne peut pas dire qu’il a compris la mécanique quantique. La connaissance est le prix d’un effort et cet effort fait se distinguer la connaissance des opinions, et partant les lieux de savoir des bistrots. En suivant cette schématisation novatrice, j’aurais tendance à dire que la curiosité devient l’alliée de la connaissance maîtrisée entre le bistrot et les lieux de savoir, soit entre le moment où le chômeur décide de quitter le bistrot pour se remettre dans le droit chemin qui le conduira probablement au lieu de savoir s’il décide de ne pas se retourner comme l’avait fait cet abruti d’Orphée. Au final, il y a ceux qui savent parler parce qu’ils savent de quoi il en retourne et ceux qui parlent pour ne rien dire parce qu’ils ne savent même pas de quoi ils ont commencé à parler alors même qu’ils achèvent une phrase syntaxiquement infirme.
Face au dualisme rationnel, je suis donc pour un parallélisme où l’être d’une chose se dit en deux occurrences : selon les attributs du monde observable et selon les attributs de la pensée. Les choses existent d’abord dans l’expérience avant de se formuler dans la pensée. Au mieux la pensée extirpe une chose avant de la replacer parmi le règne des êtres, c’est-à-dire là où elle est censée vivre. Les dualistes, eux, se plaisent à parler de choses qu’ils extirpent de leur raison même en allant parfois jusqu’à les inoculer dans le monde (sur ce point, le discours de Ratisbonne de Benoît XVI pouvait tenir sa place bien que la position papale soit à ce sujet inepte). De cette rationalité maladive émergent des comportements paranoïaques ainsi que des rejets ethniques tout à fait répréhensibles. La raison n’est qu’un outil et nous ne devons pas en faire un tournevis cruciforme qui s’adjugerait le droit de faire du monde une forme appropriée à son usage. La raison est, dans le meilleur des cas, un atout d’explication comme la botte du Mille Bornes. L’as du volant n’aura pas d’accidents de parcours, cependant il ne comprendra pas pourquoi d’autres continueront d’avoir des accidents. Si bien que la raison demeure un accident de l’esprit à l’image du génie qui s’annonce comme accident des masses. Michael Jackson, conformément à cela, incarnait la grandeur du paradoxe : était-il ceci plutôt que cela ? On a vu alors que les raisons dualistes ont voulu penser Michael Jackson sur le plan de l’être et du non-être, faisant alors du Ceci une transformation en Cela. Ces égarements de la pensée ne mettent en exergue qu’une impuissance de penser ce qui n’entre pas dans les schémas cotonneux de la raison. Si M. Merrick disait déjà dans Elephant Man « I’m just a man », si M. Jackson l’a répété en chanson, c’est que la raison humaine, si puissante soit-elle, si compétente qu’elle soit en matière d’endocrinologie, n’a pas la faculté de penser une phrase aussi simple que « I’m just a man ». Ceci fait que nos courriers, depuis le début, ont certainement été corrompus par des esprits de faible envergure. C'est que la raison n'est pas différente des caprices : elle veut plus que ce qu'elle a à sa disposition et parfois même elle veut quand elle ne peut techniquement avoir. Par conséquent la raison moderne est l'être qui fait semblant d'avoir ce qui n'est pas.
Ce retour de la fanfare au village de la réflexion est triplement bénéfique : vous amorcez une réflexion pontifiante sur la notion de monstrueux, laquelle s’accouple avec les nouveaux monstres que sont les personnalités télévisuelles fabriquées par des castings et des normes de conduite, et enfin vous faites de ces normes modernes un genre de dictature encore plus néfaste que la dictature telle que nous avons l’habitude de la fréquenter dans les livres d’histoire. Il en va alors de la santé de la pensée : comment s’orienter convenablement quand il semble évident que le bon chemin exige de la raison un éclairage plutôt qu’il ne s’annonce déjà tout éclairé ? Sur votre lancée, je déclare sans risquer l’intrépidité que la vieille rengaine des Expositions Universelles ne produit rien de véritablement pertinent, ceci dans la mesure où ce sont plutôt des attitudes commerciales qui se chevauchent au lieu d’attitudes heuristiques motivées par la curiosité. Aussi la présence d’une épice orientale sur un marché sud-américain n’a de remarquable que la capacité de maîtriser l’espace mondial. En matière d’échanges de curiosités, tout repose sur la faculté de fréquenter la curiosité sans la réduire ensuite à un processus sérigraphique. C’est pourquoi nos monstres sociaux ne sont plus particulièrement monstrueux : on leur donne un espace désigné qui leur attribue le droit d’être des monstres, ce qui permet aux systèmes judiciaires de contenir le monstrueux alors qu’ils ne le comprennent manifestement pas.
Outre cela, la vraie qualité du monstre repose sur sa capacité à être un produit de la nature alors qu’on le dit surnaturel et difforme. Je connais le succès considérable de ces émissions voyeuristes qui épient le quotidien de quelques siamois. Le cas des êtres bicéphales est selon moi un exemple de somatisation de ce dualisme rationnel contre lequel je me bats depuis des années. Deux têtes en un corps doivent-elles nous conduire à la thèse de deux âmes qui s’affrontent pour un même quignon de pain ? Ces demandes grotesques se dirigent vers un autre genre de question ridicule : l’être bicéphale doit-il être baptisé deux fois ? Peut-on envisager le mariage sans risquer le threesome qu’on connaît en France sous le nom de triolisme ? Pire encore : est-ce que la participation de ces siamois à un jeu de culture générale peut-elle être envisagée comme un acte de tricherie à qui n’a que sa tête pour banque de données ? Si le siamois est donc mieux accepté par le regard scrutateur des somnambules chômeurs qui s’avachissent des nuits durant devant la télévision, il n’en reste pas moins que le siamois devient non plus monstrueux en tant qu’être de chair mais monstrueux en tant que contournement des attitudes ludiques. A ce titre, je n’ose imaginer quels seraient les commentaires si des frères siamois devaient un jour s’adonner à la passion du football. Ceux-ci auraient deux fois plus de chance de marquer de la tête, ce qui bouleverserait le métier des statistiques aussi bien que la façon d’appréhender le commentaire des gestes techniques.
Dès lors, même si G. Canguilhem disait du monstre qu’il est un « vivant de valeur négative » (cf. La connaissance de la vie), je crois néanmoins que le monstre représente davantage un être de providence qui supprime les tentations dualistes des naturalistes en supposant un retour à la création naturelle en tant que totalité inexplorable. La prétention de la raison à se substituer aux problèmes épineux de la connaissance me paraît un homicide de la pensée au détriment d’une activité maîtrisée de la connaissance. J’entends par maîtrise de la connaissance deux critères inévitables : 1. La nécessité de ne pas se disperser dans la recherche en acceptant de laisser à qui de droit le travail en certains domaines – sur les hommes à deux têtes, le médecin aura plus de compétences que le chômeur voyeur avide de se remplir d’images alors qu’il ferait mieux de fortifier les significations de son voyeurisme inutile (ceci n’est que le mauvais côté du « divertissement » de ceux qui trouvent à se divertir de n’importe quoi en demeurant des n’importe qui). 2. Faire de la curiosité non pas une fédération de toutes les connaissances mais bien une alimentation du dialogue entre interlocuteurs statistiquement complémentaires – je ne peux ici cautionner un titre dualiste comme La belle et le clochard, œuvre pathologique et terroriste des studios Disney (aucune belle n’est jamais tombée amoureuse d’un clochard et cela n’arrivera jamais au vu des normes qui régulent la société). L’aboutissement de la connaissance maîtrisée consisterait en une sorte de connaissance sophrologique où la raison, au pinacle de son exercice, accepterait de reculer en s’apercevant qu’elle s’immisce sur des territoires qui ne sont pas réels mais créés de toutes pièces par elle à la seule fin de se donner l’illusion qu’un espace théorique saura résoudre les maladies de l’espace expérimental. C’est en ce sens que le chômeur, à l’instar de l’étudiant de basse-cour, ne peut pas dire qu’il a compris la mécanique quantique. La connaissance est le prix d’un effort et cet effort fait se distinguer la connaissance des opinions, et partant les lieux de savoir des bistrots. En suivant cette schématisation novatrice, j’aurais tendance à dire que la curiosité devient l’alliée de la connaissance maîtrisée entre le bistrot et les lieux de savoir, soit entre le moment où le chômeur décide de quitter le bistrot pour se remettre dans le droit chemin qui le conduira probablement au lieu de savoir s’il décide de ne pas se retourner comme l’avait fait cet abruti d’Orphée. Au final, il y a ceux qui savent parler parce qu’ils savent de quoi il en retourne et ceux qui parlent pour ne rien dire parce qu’ils ne savent même pas de quoi ils ont commencé à parler alors même qu’ils achèvent une phrase syntaxiquement infirme.
Face au dualisme rationnel, je suis donc pour un parallélisme où l’être d’une chose se dit en deux occurrences : selon les attributs du monde observable et selon les attributs de la pensée. Les choses existent d’abord dans l’expérience avant de se formuler dans la pensée. Au mieux la pensée extirpe une chose avant de la replacer parmi le règne des êtres, c’est-à-dire là où elle est censée vivre. Les dualistes, eux, se plaisent à parler de choses qu’ils extirpent de leur raison même en allant parfois jusqu’à les inoculer dans le monde (sur ce point, le discours de Ratisbonne de Benoît XVI pouvait tenir sa place bien que la position papale soit à ce sujet inepte). De cette rationalité maladive émergent des comportements paranoïaques ainsi que des rejets ethniques tout à fait répréhensibles. La raison n’est qu’un outil et nous ne devons pas en faire un tournevis cruciforme qui s’adjugerait le droit de faire du monde une forme appropriée à son usage. La raison est, dans le meilleur des cas, un atout d’explication comme la botte du Mille Bornes. L’as du volant n’aura pas d’accidents de parcours, cependant il ne comprendra pas pourquoi d’autres continueront d’avoir des accidents. Si bien que la raison demeure un accident de l’esprit à l’image du génie qui s’annonce comme accident des masses. Michael Jackson, conformément à cela, incarnait la grandeur du paradoxe : était-il ceci plutôt que cela ? On a vu alors que les raisons dualistes ont voulu penser Michael Jackson sur le plan de l’être et du non-être, faisant alors du Ceci une transformation en Cela. Ces égarements de la pensée ne mettent en exergue qu’une impuissance de penser ce qui n’entre pas dans les schémas cotonneux de la raison. Si M. Merrick disait déjà dans Elephant Man « I’m just a man », si M. Jackson l’a répété en chanson, c’est que la raison humaine, si puissante soit-elle, si compétente qu’elle soit en matière d’endocrinologie, n’a pas la faculté de penser une phrase aussi simple que « I’m just a man ». Ceci fait que nos courriers, depuis le début, ont certainement été corrompus par des esprits de faible envergure. C'est que la raison n'est pas différente des caprices : elle veut plus que ce qu'elle a à sa disposition et parfois même elle veut quand elle ne peut techniquement avoir. Par conséquent la raison moderne est l'être qui fait semblant d'avoir ce qui n'est pas.
Bien à vous cher professeur Bouachiche,
K. Deveureux.

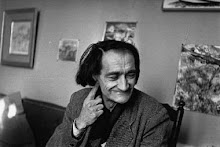
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire